Comme le révélateur en photographie, la preuve numérique fait apparaître l’invisible au tribunal, transformant les nuances de gris des données en noir et blanc.
Depuis l’antiquité, la preuve – du latin probare signifiant démontrer -, est bâtie sur deux principes que sont la loyauté et la proportionnalité. C’est grâce à l’article 9 du Code de procédure civile – « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », que l’on comprend la nécessité de contrôler le caractère irréfutable des preuves sur la base desquelles le juge va rendre sa décision.
L’histoire nous montre que l’importance de la preuve est ancienne, comme en témoigne l’anecdote de Cicéron utilisant une main coupée pour influencer le cours d’un procès au 1er siècle avant JC.
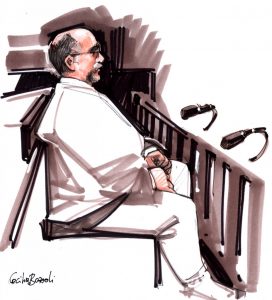
Ici, l’utilisation inattendue d’un élément visuel et dramatique comme moyen de persuasion dans le procès constitue une approche provocante pour captiver l’attention du jury et établir un lien émotionnel avec l’affaire. L’importance de la persuasion et de la perception dans le processus de preuve est un élément crucial dans le système judiciaire, servant de fondement pour l’établissement des faits et l’application équitable de la loi. Elle assure la protection des droits individuels en permettant des décisions basées sur des éléments concrets plutôt que sur des conjectures, contribuant ainsi à prévenir les erreurs judiciaires et à renforcer la confiance du public dans l’intégrité du système juridique.
C’est avec l’avènement d’internet au début des années 80, notamment par la photocopieuse, qui marque le début de l’ère numérique que sont apparues de nouvelles interrogations quant à la forme de la preuve. C’est par la loi n°80-525 du 12 juillet 1980 introduisant l’article 1348, al. 2e dans le Code civil qui a renforcé la valeur juridique des copies en leur conférant une force probante autonome. Malgré ce bouleversement, la théorie de la preuve n’a pas directement été adaptée, et les principes de respect de la vie privée et de loyauté demeurent inchangés. Dans notre monde où l’information est constante, les informations numériques (contenus, logiciels) deviennent des ressources clés dans les activités de la société. L’ère du numérique transforme aujourd’hui notre manière de vivre, où tout un vivier d’informations est nécessaire de stocker, traiter et transmettre en permanence. Ces traitements font apparaître des supports offrant de nouvelles opportunités, notamment dans l’établissement de faits dans un cadre judiciaire. La collecte et l’analyse de preuves ont à ce titre évolué, nécessitant une adaptation continue des méthodes légales pour garantir leur fiabilité et leur pertinence dans le processus judiciaire.
Aujourd’hui, les preuves ne sont plus des objets physiques comme dans le jeu du Cluedo, mais des éléments digitaux tels que les suites binaires. En droit français, la preuve numérique n’est pas spécifiquement définie par le droit. Elle est reconnue juridiquement au tournant des années 2000 par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique. Cette adaptation permet de reconnaître la valeur probante de documents issus d’un support électronique. Cette mention regroupe une diversité d’éléments, notamment sous deux formes : tout support papier convertis en format numérique (lettres, cartes d’identités, photographies etc), et les données directement obtenues par divers types de technologies (géolocalisation). La célèbre Affaire Enron (2001) qui a mis en lumière un scandale par des manipulations massives de données avec des emails et fichiers numériques, illustre parfaitement les défis posés par la gestion et l’analyse de vastes quantités de données numériques en tant que preuves. Par ailleurs, l’article 1366 du Code civil dispose que “L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”. La preuve n’est donc plus liée au support, mais son origine est à démontrer contrairement à l’écrit papier qui ne nécessite pas de transcription puisque l’information est directement signifiante. Dans ce contexte, des applications comme Olvid, qui chiffrent les communications sans stocker d’informations personnelles et utilisent des QR codes pour l’authentification, représentent un défi supplémentaire.
En droit civil ou pénal, l’apport de la preuve possède des règles différentes. Qu’elle soit libre ou écrite, le législateur a dû intervenir pour s’adapter à la montée en puissance des nouvelles technologies. La norme ISO/CEI 27037, en 2012, représente une avancée significative dans la standardisation des processus relatifs aux preuves numériques dans le cadre juridique. Cette norme est venue apporter un cadre pour la fiabilité des preuves numériques, établissant les lignes directrices pour leur identification, collecte, acquisition et préservation.
Les techniques d’enquête numérique judiciaire sont donc devenues une obligation pour naviguer dans ce monde moderne avec des données électroniques et des éléments virtuels souvent au cœur des litiges. Le caractère probant de la preuve est nécessaire, même dans un contexte évolué et technologique. Cependant, un questionnement survient quant à la nature de la preuve juridique. Dans un contexte où les supports peuvent être facilement altérés, la question de garantir l’authenticité, la fiabilité et l’intégrité des preuves numériques demeure prépondérante, surtout par l’arrivée de nouvelles technologies disruptives (blockchain) présentant de nouveaux défis pour le législateur en termes de compréhension. Cette technologie en chaîne constituant le futur de la preuve, ne tarde pas à connaître également des évolutions en termes de texte. Depuis le décret du 24 décembre 2018, le Dispositif d’Enregistrement Électronique Partagé (DEEP, blockchain) est considéré comme une preuve légale.
L’évolution constante des technologies remet profondément en question les paradigmes traditionnels de la preuve juridique. Cependant, la législation reste souvent floue quant à la portée exacte de la valeur probatoire de ces technologies, suscitant ainsi des questionnements sur leur utilisation concrète en justice.
Ces considérations nous amènent à explorer une problématique essentielle : Par quels moyens et dans quelles mesures la preuve s’adapte-t-elle à l’ère numérique ?

